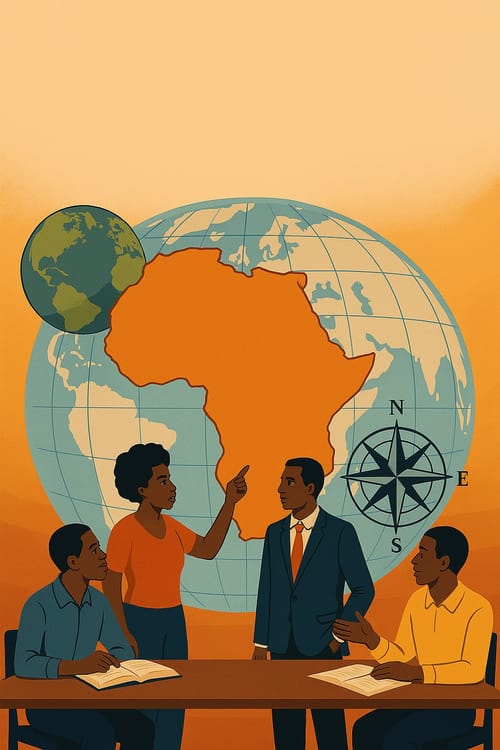Dans un monde de plus en plus interconnecté et concurrentiel, la géopolitique revient au centre des débats publics et stratégiques. Trop souvent considérée comme une discipline réservée aux diplomates ou aux universitaires, elle s’impose pourtant comme un outil indispensable pour comprendre les dynamiques contemporaines, en particulier sur le continent africain.
Qu’est-ce que la géopolitique ?
La géopolitique est, selon Yves Lacoste, géographe et fondateur de la revue Hérodote, « l’étude des rapports de force dans l’espace » (La Géographie, ça sert d’abord à faire la guerre, 1976). Elle croise géographie, histoire, culture, symboles et intérêts politiques, et ne se limite pas à l’analyse des conflits militaires. Il s’agit de comprendre comment territoires, ressources, cultures ou frontières influencent les choix des États et des sociétés.
La notion de géopolitique émerge à la fin du XIXe siècle avec le politologue suédois Rudolf Kjellén, auteur de Staten som livsform (L’État comme forme de vie, 1916), qui pose les bases de la discipline. L’école française, portée par Lacoste, insiste sur le fait que l’espace n’est pas un déterminisme : ce sont les sociétés humaines qui façonnent et interprètent les territoires.
Les spécificités de l’approche française
Contrairement aux écoles anglo-saxonnes, souvent centrées sur l’approche militaire (Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, 1919), ou à l’école allemande, marquée par le déterminisme géographique (Friedrich Ratzel, Politische Geographie, 1897), l’école française de géopolitique est possibiliste et multidimensionnelle. Elle privilégie la cartographie, l’observation de terrain, l’analyse historique et la prise en compte des représentations culturelles (Yves Lacoste, Dictionnaire de géopolitique, 1993).
Les frontières, explique Michel Foucher, géographe et ancien ambassadeur, dans L’Obsession des frontières (2007), sont des constructions humaines : fleuves, montagnes ou déserts ne deviennent des limites politiques que par la volonté des sociétés.
En afrique...
Le Sahara, souvent perçu comme une barrière naturelle, fut longtemps un espace d’échanges et de circulation culturelle entre l’Afrique subsaharienne et le Maghreb. Ce n’est qu’avec la colonisation et la création de frontières arbitraires que cette région est devenue un « no man’s land » géopolitique.
L’Afrique au prisme de la géopolitique
L’Afrique se distingue par une complexité géopolitique exceptionnelle, résultant :
- les frontières africaines, tracées lors de la conférence de Berlin (1884-1885) sans tenir compte des réalités ethniques et culturelles, sont à l’origine de nombreux conflits et tensions sur le continent.
- l’Afrique possède d’immenses ressources naturelles (pétrole, minerais, terres rares) et une position géostratégique majeure, ce qui attire de nombreux acteurs étrangers et alimente les rivalités internationales.
- de dynamiques internes puissantes, entre urbanisation rapide, conflits identitaires et résurgences religieuses.
Prenons quelques exemples pour expliquer les dynamiques de changement géopolitique en Afrique :
le conflit au Sahel : Le Sahel est aujourd’hui l’un des épicentres géopolitiques du continent. Entre lutte contre le terrorisme, compétition entre puissances étrangères (France, Russie, États-Unis), et coups d’État militaires (Mali, Niger, Burkina Faso), on assiste à une recomposition des alliances régionales, comme l’opposition entre l’Alliance des États du Sahel (AES) et la CEDE (Council on Foreign Relations, 2024).
le Sahara occidental : La reconnaissance par Donald Trump, 45ᵉ président des États-Unis, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en 2020 n’est pas le fruit d’une stratégie diplomatique complexe, mais d’un jeu d’intérêts électoraux et personnels. Ce cas illustre le principe formulé par Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État américain et auteur de Diplomacy (1994) : « Les États n’ont pas d’amis, seulement des intérêts. »
le barrage de la Renaissance (Éthiopie – Égypte – Soudan) : La construction du barrage de la Renaissance par l’Éthiopie sur le Nil Bleu est un cas emblématique de géopolitique de l’eau. L’Égypte, dépendante du Nil, considère ce projet comme une menace existentielle, tandis que l’Éthiopie y voit un levier de développement (Al Jazeera, 2021). Les négociations illustrent l’importance de la compréhension des ressources, des perceptions et des héritages historiques.
Méthodologie de la géopolitique : terrain, échelles et réalisme
Faire de la géopolitique, c’est :
- observer le terrain et les réalités vécues, au-delà des discours officiels;
- analyser à différentes échelles : locale, régionale, internationale;
- adopter une posture réaliste, en étudiant les intérêts concrets plutôt que les discours idéologiques
Par exemple, la présence militaire française en Afrique, officiellement justifiée par la lutte contre le terrorisme, répond aussi à des enjeux stratégiques, économiques et symboliques, comme la protection d’intérêts économiques ou l’affirmation d’une influence culturelle (Jean-Pierre Bat, historien, La France en Afrique, 2015).
Les symboles et la spiritualité comptent aussi
L’Afrique ne peut se comprendre sans intégrer sa dimension spirituelle, symbolique et culturelle. Les masques, vêtements, langues ou pratiques religieuses ont une portée géopolitique majeure. Comme le rappelle Achille Mbembe (Critique de la raison nègre, 2013), des objets comme le kéfié palestinien ou le turban touareg incarnent des identités et des engagements politiques.
En conclusion : pourquoi la géopolitique est vitale pour l’Afrique ? L’Afrique ne doit plus être un simple objet de la géopolitique mondiale, mais devenir un sujet, produire ses propres analyses, défendre ses intérêts et redéfinir ses alliances.
Comprendre la géopolitique, c’est :
- reprendre le contrôle sur ses territoires ;
- penser stratégiquement à long terme ;
- dépasser les slogans pour affronter la réalité des rapports de force.
C’est un impératif pour les décideurs, les citoyens engagés, les étudiants et tous ceux qui croient en l’avenir du continent.